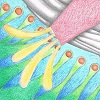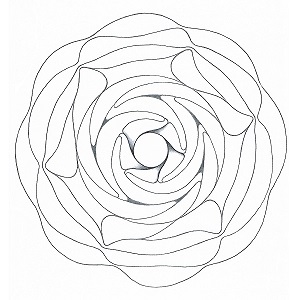![]()
Les pensées peuvent être décrites par les idées, à l’intérieur des idées se trouvent les images psychiques de représentations déjà maintes fois évoquées.
La représentation est ainsi une charpente qui met en œuvre le processus de la pensée au travers d’un enchaînement d'actions opérationnelles.
![]()
Un schéma (stratégie) d'adaptation est une représentation d’action comportant une compulsion mentale : « lorsque je suis face à une noyade, la représentation dépasse l’étape de la réflexion pour me signifier de porter secours à la victime ; la représentation mentale est l’image du bon sauveteur portant secours ».
La représentation peut être inadaptée à la circonstance et préjudiciable à la vie psychique : « lorsque je suis face à une noyade, la représentation dépasse l’étape de la réflexion pour me signifier de prendre la fuite ; la représentation mentale impliquée est l’image mentale du sauve-qui-peut de l’instinct de survie devant le danger ».
Dans cette situation, l’idée représentative peut être destructrice dans le sens qu’elle provoque la culpabilité de ne pas avoir été bienveillant en ne portant pas secours, elle suscite la curiosité inquiétante de savoir si la personne a réchappé à la mort et engendre la peur d’avoir été vu, dénoncé et sanctionné.
![]()
Une attention consciente centrée sur les représentations engage à les examiner et à les critiquer.
Relier les sentiments aux représentations qui les produisent conduit à une profonde réflexion sur les motifs originaux acquis par l’apprentissage et les circonstances de la vie.
Étudier la matière conceptuelle (signification) des représentations (idées) tisse des liens conscients entre les mécanismes (automatismes) d’actions actuels et les circonstances émotionnelles qui les ont conçues.
C’est par le détachement ou le réajustement des liens symboliques-représentatifs que l’individu devient réellement authentique, n’étant plus soumis à des pensées ou à des comportements acquis (conditionnés) créés de la nécessité d’une impulsion.
Ne plus se sentir programmé, c’est s’autoriser à agir différemment pour être capable d’accepter tout ce qui advient.
![]()
Le phénomène est la concrétisation qui manifeste la chose en soi dont il émane par ses fonctions et ses effets dans la matière, sa perception dépend des moyens d’observation de celui qui l’observe.
Étant une résonance de l’inconscient et du corps mémoriel (la conscience est une pensée associée au corps), la conscience pourrait se constituer comme le phénomène de son inconscient et non comme seule raison de ses actes et de ses pensées.
Croire que la conscience est la seule entité psychique relève probablement d’une illusion.
La part consciente, au travers de la pensée, n’a donc accès qu’à une partie des choses : « penser que je connais précisément les raisons qui me font agir est une trahison de moi-même ou une plaisanterie cynique car leurs motifs fondamentaux sont inconscients, échappant à la surface consciente ».
![]()
La conscience partage ainsi ses perceptions en niveaux de conscience pouvant coexister simultanément :
1. conscience de l’attachement physique et instinctuel
2. conscience du discernement perceptif et sensitif
3. conscience du corps émotionnel, énergétique et intuitif, composent les plans de conscience préliminaires se développant au cours de l’évolution de l’individu suivant l’acuité de ses perceptions.
« Pour réaliser mes instants de vie je peux élever mes niveaux de conscience en établissant des perceptions justes par l’acuité de mes fonctions psychiques et sensorielles », c’est-à-dire en portant une écoute attentive aux sensations, aux fonctions physiologiques (principalement la respiration) et à l’intuition.
Les premiers plans de conscience se prolongent dans les suivants :
4. conscience de la compréhension mentale rationnelle et représentative
5. conscience de la personnalité causale et phénoménologique
6. conscience du lien en tant que volonté de l’âme bienveillante (altruiste), qui considère le rapport de l’être avec son histoire, ses idées, ses représentations et ses croyances.
Les niveaux ultimes de conscience relèvent d’expériences intérieures et de questionnements existentiels achevés :
7. conscience congruente accordée par la reconnaissance et l’acceptation entière de soi
8. conscience de soi réfléchie, isolée, détachée de l’effort de la volonté (intention)
9. conscience de l’individuation émanant de la correspondance de l’individu avec son inconscient
10. conscience de l’immanence (intégration du rôle participatif) de l’être dans les systèmes planétaire, solaire, cosmique et universel. Ces derniers plans réalisent les questions de « l’être vrai, l’être par soi, l’être en devenir » et de leurs significations, indépendamment de ses déterminations (physiques - génétiques, psychiques – généalogiques, éducatives - sociétales).